Sur les flancs escarpés des cirques volcaniques de La Réunion, vivent encore quelques milliers de Français. Ils s’appellent de Boisvillier, Clain ou Payet, portent parfois un nom à particule, un héritage nobiliaire d’un autre temps. Mais aujourd’hui, leur noblesse s’est enlisée dans la pauvreté, l’oubli, et parfois la honte.
En 1989, l’émission « 52 à la Une », présentée par Jean Bertolino et diffusée en deuxième partie de soirée sur TF1 entre 1988 et 2001, consacre un reportage à une population alors méconnue du grand public : les « petits Blancs des Hauts ». Le documentaire, éponyme, fera grand bruit. Accusé de dépeindre les Réunionnais comme des êtres consanguins, alcooliques, analphabètes et vivant des allocations, il soulèvera un tollé aussi bien dans l’île qu’en métropole.
À la fin des années 1980, dans un contexte où La Réunion commence à faire entendre sa voix contre les clichés coloniaux persistants, ce reportage choque. Pour certains, il donne à voir une réalité sociale occultée. Pour d’autres, il renforce une vision misérabiliste et stigmatisante d’un territoire ultramarin encore mal connu et mal compris par l’Hexagone.
Le 21 mai 2025, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) a rediffusé le reportage sur sa chaîne YouTube, ravivant les mémoires et relançant les débats autour de ce document devenu, malgré lui, une archive sensible.
Trente-cinq ans plus tard, alors que les Hauts ont partiellement changé de visage, les stigmates de cet isolement persistent. Si le documentaire a cristallisé les tensions, il a aussi laissé une trace, une mémoire, une parole brute. Revisiter aujourd’hui ce témoignage, c’est interroger non seulement la manière dont les médias regardent les marges, mais aussi ce que l’île fait de ses fantômes.
Une séquence marquante montre aussi Madame Visnelda à l’Étang-Salé, en train de réaliser une séance de désenvoutement, entre prières créoles et gestes rituels, dans une ambiance mystique.
Au fond du cirque de Mafate, là où la route s’arrête bien avant la dernière maison, tout arrive du ciel. Nourriture, matériaux, médicaments : l’hélicoptère est le seul lien tangible avec le reste du monde. Pour le reste, on marche, parfois cinq ou six heures, le long de sentiers vertigineux. Ici, vivent ce que La Réunion appelle pudiquement « les petits Blancs des Hauts ». Une minorité invisible, isolée dans les montagnes, à l’abri — ou à l’écart — des mutations de l’île moderne.
Descendants directs des premiers colons venus s’installer à Bourbon aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces familles ont tout perdu : leurs terres, vendues ou morcelées par les héritages, leur statut, effacé par l’histoire. Ne leur reste que le nom, parfois glorieux, mais vidé de sa superbe. « De Boisvillier, c’était un chevalier », souffle une vieille dame, anciennement dentiste, dans une case branlante rongée par les termites, à Saint-Denis. Elle a retrouvé dans de vieux registres la trace de leur ancêtre, Antoine, débarqué en 1757 avec pour seul bagage sa « culotte dans la main ».
Dans les hauts, le patriarche Antoine de Boisvillier vit avec les siens comme autrefois : un monde clos, replié, hérité du servage sans terre. « La misère, nous connaît », dit-il en créole. Autour de lui, des enfants aux cheveux roux, des visages burinés, un langage métissé de vieux français et de créole inintelligible. Il faut « montrer comment il faut faire travail », répète-t-il à son fils. Le vin qu’ils boivent ? Issu d’un cépage interdit — l’Isabelle — qui rendrait « fou ». L’école ? Parfois absente. Les enfants ne savent ni lire ni écrire, les maîtres sont rares. Dans certaines classes, seuls quatre mois d’enseignement sont assurés dans l’année.
Le désespoir se transmet parfois comme un patrimoine : alcoolisme, consanguinité, handicaps physiques et mentaux. « Dans notre famille, il y a des sourds et muets sur plusieurs générations », témoigne Marie-Jeanne, qui s’occupe de deux oncles atteints. Un médecin, surnommé le « docteur de Mafate », a même retrouvé des traces d’alcool dans le sang d’enfants de 8 ans. « Un petit rhum pour la grippe », diront les parents.
Pourquoi rester ? Parce que partir n’est plus une option. « Le campé est venu là, moi reste là », lâche Antoine. Et les mariages ? Ils se font entre cousins, par manque de choix, de mobilité, ou par habitude. Le repli a fait société. Même la religion se mêle aux superstitions, dans des cérémonies de « désenvoûtement » à la lisière de l’exorcisme.
À la Réunion, ce pan de l’histoire dérange. On préfère parler de vivre-ensemble que de cette communauté reléguée, « française de souche », mais sans les privilèges. Les petits Blancs des Hauts sont les exclus d’un monde moderne qui les a laissés derrière. Ils ne font l’objet d’aucune politique publique spécifique. Ils n’entrent dans aucune statistique. On ne parle pas d’eux.
Et pourtant. Ils sont là, entre deux ravines, dans une case de tôle ou de bois, aux noms de noblesse fatiguée, à vivre avec 3 600 francs d’allocations. Les vieux meurent en silence, les jeunes s’en vont parfois, honteux ou résignés. Mais la plupart restent, enracinés sur cette terre volcanique, fertile, indomptable, comme eux.
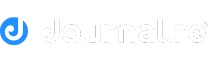
















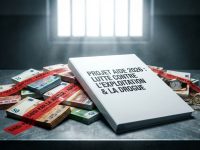





0 Comments