Le cyclone Jenny, au nom trompeusement doux, reste gravé dans la mémoire des Réunionnais. En moins de deux heures, le 28 février 1962, il a bouleversé l’île, laissant derrière lui des dizaines de morts, des blessés et des milliers de sinistrés. Retour sur cet épisode tragique de l’histoire cyclonique de La Réunion.
La naissance d’un cyclone intense dans l’océan Indien
Le 25 février 1962, au large de Diego Garcia, une dépression se forme dans l’océan Indien. À l’époque, les moyens météorologiques sont rudimentaires : peu de stations, des relevés incomplets et aucune technologie satellitaire moderne. Trois jours plus tard, la dépression devient un cyclone intense baptisé Jenny.
D’un diamètre restreint mais animé d’une vitesse impressionnante, Jenny épargne Rodrigues mais fonce droit vers Maurice et La Réunion.
La veille d’un piège mortel
Le 28 février au matin, la RTF diffuse un bulletin météo jugé insuffisant pour alerter la population réunionnaise. À Maurice, l’alerte est donnée, mais à La Réunion, la vie suit son cours normal :
- Les employés se rendent au travail,
- Les pêcheurs sortent en mer,
- Les enfants profitent de leurs vacances.
Le ciel, bleu quelques jours auparavant, s’assombrit sans inquiéter outre mesure les habitants. Jenny tend son piège.
Quand Jenny déferle sur La Réunion
Attendu vers 14h, le cyclone frappe finalement à 12h30. Pris de court, de nombreux pêcheurs ne parviennent pas à regagner la côte. Neuf périssent en mer.
Les rafales atteignent localement 280 km/h, déracinant arbres, détruisant maisons et infrastructures. À 13h30, le passage de l’œil du cyclone offre une courte accalmie, avant que les vents ne reprennent avec une violence accrue. En moins de deux heures, Jenny traverse l’île et s’éloigne, aussi rapidement qu’il était arrivé.
Le lourd bilan humain et matériel
Le passage de Jenny laisse derrière lui :
- 37 morts,
- 150 blessés,
- 13 000 sans-abri,
- Un village rayé de la carte : Les Galets, situé entre Sainte-Anne et Saint-Benoît.
Ce désastre marque durablement la mémoire réunionnaise.
Polémiques et recherche de responsables
Dès le lendemain, la presse pointe du doigt la mauvaise gestion de l’alerte. Le préfet Perreau-Pradier est critiqué, tout comme le chef du service météorologique. Le drame met en lumière les lacunes de l’époque en matière de prévision cyclonique.
Une mémoire qui alerte encore aujourd’hui
Si le cyclone Jenny reste un traumatisme, il a aussi permis une prise de conscience. Aujourd’hui, grâce aux satellites, radars et modèles météorologiques sophistiqués, la prévision est plus précise et les plans d’alerte cyclonique mieux coordonnés. Ces avancées limitent les risques de catastrophes humaines comparables à celles de 1962.
Cyclone Jenny : un souvenir douloureux mais nécessaire
Plus d’un demi-siècle plus tard, le nom de Jenny évoque encore l’une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine de La Réunion. Ce drame rappelle l’importance d’une culture du risque cyclonique et de la vigilance face aux forces de la nature.
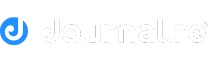






















avec denise et firinga le plus fort en vent hyachinte la pluie