Longtemps dominée par des figures masculines emblématiques comme Maxime Laope ou Firmin Viry, la scène maloya connaît une évolution majeure : des voix de femmes puissantes, engagées et inspirantes prennent désormais le devant de la scène. Elles chantent l’histoire, la liberté, l’amour, mais aussi les combats d’aujourd’hui. Zoom sur ces femmes qui réinventent le maloya tout en gardant vivante la mémoire de La Réunion.
Le maloya, ce chant de l’âme et de la résistance, fut longtemps un domaine réservé aux hommes. Traditionnellement transmis de père en fils, il servait à chanter les douleurs de l’esclavage, la mémoire des ancêtres, les luttes sociales. Mais dans les coulisses, des mères, des sœurs, des grand-mères ont toujours porté cette culture, souvent dans l’ombre.
Parmi les figures phares de ce renouveau féminin du maloya, Christine Salem s’impose comme une référence. Sa voix grave et magnétique, ses textes puissants, sa spiritualité palpable en ont fait une ambassadrice du maloya moderne. Elle mêle traditions et musiques du monde, bousculant les codes sans les renier.
Autre figure montante : Maya Kamaty, fille de Gilbert Pounia (leader de Ziskakan), qui marie le maloya à l’électro, au slam et au chant poétique. Dans ses morceaux, elle raconte La Réunion d’aujourd’hui, entre héritage et modernité, féminité et rébellion.
D’autres artistes féminines comme Ann O’aro, Tina Mweni ou encore Tine Poppy explorent aussi le maloya sous un angle poétique, politique ou expérimental. Elles participent à renouveler la scène en y apportant leur propre vécu, souvent marqué par les luttes sociales, la condition féminine ou les identités multiples.
Ces artistes partagent un objectif commun : dépoussiérer les clichés autour du maloya et affirmer une présence féminine forte, dans un univers encore perçu comme traditionnellement masculin. Certaines mettent en avant des thèmes intimes, comme la maternité ou la violence conjugale ; d’autres dénoncent les discriminations ou chantent l’écologie et les droits humains.
Ce maloya féminin s’illustre aussi dans les cours de danse, les groupes de quartier, les écoles, où des femmes transmettent cette culture aux plus jeunes. Loin des projecteurs, elles sont les gardiennes du rythme et de la parole.
Pour de nombreuses Réunionnaises, voir des femmes chanter le maloya, c’est se reconnaître dans une histoire collective. C’est revendiquer une place, une voix, un tambour battant. C’est aussi revivre le maloya comme un art de vivre : dans la cuisine, sur les marchés, lors des kabars, dans les rituels.
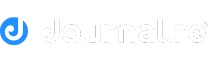


















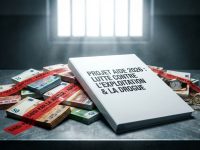



0 Comments