Pourquoi les sources non citées ?
Dans le journalisme d’investigation, beaucoup d’informations proviennent de « sources off » — anonymes, non identifiées — qui acceptent de parler sans être citées, pour des raisons de sécurité, d’emploi ou de pouvoir interne.
Ce principe est fondamental : sans l’anonymat garanti, de nombreuses révélations ne verraient jamais le jour. Comme l’explique un rapport français : « les sources les mieux informées … sont souvent aussi celles qui ne peuvent être citées ».
Plus encore, la protection du secret des sources relève « de l’essence même du métier » de journaliste.
Les risques et les limites
Mais dans cette zone grise se nichent plusieurs dilemmes :
- Une source non citée peut être moins responsable de ses propos : difficile de vérifier ses motivations ou biais.
- Le recours systématique à l’anonymat peut fragiliser la crédibilité de l’article : le lecteur peut se dire : « Et si c’était juste une rumeur ? »
- Comme le rappelle l’entreprise Agence France‑Presse : « nous ne devons recourir aux sources anonymes que lorsque nous ne pouvons obtenir une information importante par un autre moyen. Leur utilisation doit être l’exception plutôt que la règle. »
- Enfin, selon les lois, la protection du secret des sources n’est pas absolue : elle peut être levée si un « impératif prépondérant d’intérêt public » le justifie.
Quelques cas réels (anonymisés)
- Un journaliste enquête sur des dysfonctionnements internes d’un service public. Une source « off » accepte de témoigner à condition de rester anonyme. Le dossier paraît : sans nom, l’institution accuse le média de manquer de transparence.
- Lors d’une affaire de sécurité nationale, un lanceur d’alerte transmet des documents à un média. Il ne souhaite pas être cité pour des raisons de représailles. Le média publie l’article, puis est convoqué par les services pour révéler ses sources. Ce type d’atteinte au secret des sources est dénoncé par des organisations de presse.
À La Réunion : enjeu local
Dans un territoire comme La Réunion, où les réseaux sont étroits et les équilibres humains complexes, le recours aux sources anonymes est fréquent : témoignages d’habitants, de fonctionnaires, de petites structures. Le journaliste doit alors conjuguer deux impératifs :
- Garantir l’anonymat sans tomber dans le flou (ex : « un employé d’un service public »).
- Maintenir la crédibilité de son article en donnant des repères précis (contexte, recoupements, documents) même si le témoin reste non identifié.
La règle d’or éthique
- Utiliser l’anonymat uniquement lorsque l’information est essentielle et que la source ne peut être crédibilisée autrement.
- Expliquer au lecteur pourquoi la source est restée anonyme (sans pour autant dévoiler son identité).
- Recouper l’information, vérifier les faits, limiter les spéculations.
- Transparence envers le public : indiquer clairement la nature de la source (« un témoin », « un fonctionnaire », etc.), mais pas nécessairement le nom.
“Off” : ce mot‑clé derrière lequel se joue une part invisible du journalisme.
La confiance du lecteur ne s’achète pas par la citation de chaque nom, mais par la rigueur du journaliste.
Et si l’anonymat est protégé, c’est parce que le métier ne pourrait pas se faire autrement. Mais ce privilège exige une responsabilité accrue.
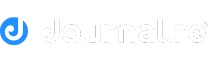








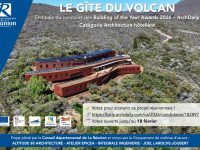












0 Comments