Autrefois, l’île de La Réunion abritait une créature fascinante et majestueuse : la Tortue terrestre de Bourbon (Cylindraspis indica). Endémique de l’île, cette espèce géante, proche cousine des fameuses tortues des Galápagos, parcourait les forêts semi-sèches et les littoraux, occupant une place essentielle dans l’équilibre écologique de l’île. Aujourd’hui disparue, elle demeure dans les mémoires comme l’un des plus grands symboles de la richesse naturelle perdue de La Réunion.
Une population autrefois gigantesque
Au XVIIe siècle, la présence des tortues terrestres de Bourbon était tout simplement colossale. Les estimations évoquent plus de 2 millions d’individus, principalement sur la côte sous le vent. Les témoignages des premiers colons décrivent des scènes presque irréelles : à la tombée de la nuit, de véritables troupeaux descendaient des montagnes, envahissant les camps humains et traversant les villages en masse. Certaines s’approchaient même des hommes pour leur lécher les pieds, phénomène qui marquait l’imaginaire collectif.
Les plages noires, notamment celles de Saint-Paul, résonnaient de ce ballet impressionnant, donnant à l’île un aspect vivant et sauvage que l’on ne peut qu’imaginer aujourd’hui.
Les causes de la disparition : entre colonisation et surexploitation
Cette abondance, loin d’être protégée, devint rapidement une ressource exploitée sans limite. Les tortues furent massivement chassées par les colons dès l’arrivée des Européens. Leur lenteur en faisait une proie facile, mais c’est surtout leur capacité à survivre de longs mois sans nourriture qui les rendait précieuses : elles étaient embarquées par dizaines sur les navires, servant de garde-manger vivant pour les équipages en route vers l’Europe, l’Inde ou Madagascar.
Dès les années 1770, la tortue terrestre de Bourbon avait déjà disparu des zones habitées et ne se retrouvait plus que dans les endroits les plus isolés de l’île, comme l’Îlet à Cordes à Cilaos. Sa disparition définitive survint vers 1840, scellant la perte d’un maillon essentiel de l’écosystème réunionnais.
Des conséquences écologiques durables
L’extinction de la Tortue terrestre de Bourbon ne fut pas qu’une perte symbolique : elle bouleversa profondément l’équilibre naturel. Ces tortues jouaient un rôle de dispersion des graines et de germination pour plusieurs espèces végétales endémiques. Parmi elles, le fameux Bois Puant, qui dépendait en grande partie du passage digestif des tortues pour se régénérer.
Sans elles, la forêt semi-sèche de l’Ouest perdit une partie de sa dynamique écologique, ouvrant la voie à des déséquilibres encore visibles aujourd’hui.
L’espoir d’une réintroduction écologique
Mais tout n’est pas perdu. Conscients de l’importance écologique de ces tortues, des chercheurs et acteurs de la biodiversité réunionnaise portent un projet novateur : la réintroduction de la Tortue géante d’Aldabra (originaire des Seychelles). Cette espèce, très proche de la défunte Cylindraspis indica, pourrait remplir les mêmes fonctions écologiques dans les forêts semi-sèches de l’île.
En parallèle, des structures comme Kélonia à Saint-Leu poursuivent leur mission de préservation et de sensibilisation autour des tortues, qu’elles soient marines ou terrestres. Ces efforts rappellent que, si la Tortue de Bourbon appartient désormais au passé, son rôle écologique peut être en partie réhabilité par des actions humaines responsables et tournées vers l’avenir.
Un symbole fort pour La Réunion
La Tortue terrestre de Bourbon incarne à la fois la splendeur disparue de la biodiversité réunionnaise et la nécessité urgente de protéger ce qu’il reste. Son histoire dramatique illustre l’impact destructeur de la colonisation et de la surexploitation des ressources naturelles, mais elle ouvre aussi une réflexion sur la résilience et la capacité de l’homme à réparer — en partie — ses erreurs.
Préserver et restaurer la biodiversité, c’est honorer cette mémoire et offrir aux générations futures une île vivante, équilibrée et respectée.
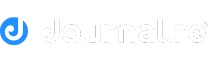






















0 Comments