À La Réunion, difficile d’imaginer une fête, un kabar ou même une simple réunion de famille sans musique. Deux genres dominent et font battre le cœur de l’île : le maloya et le séga. Bien plus que des rythmes, ils sont le reflet de l’histoire, des souffrances, mais aussi de la joie et de la résistance du peuple réunionnais.
Classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO, le maloya est bien plus qu’un style musical : c’est une mémoire vivante, née de la douleur et de la résistance des esclaves. Aujourd’hui, il s’invite aussi bien dans les kabars traditionnels que sur les scènes internationales.
Loin de rester figés dans le passé, le maloya et le séga inspirent une nouvelle génération d’artistes réunionnais. Certains mixent le maloya avec de l’électro, d’autres marient le séga avec du hip-hop. Le résultat : une musique toujours vivante, qui s’exporte à l’international et séduit un public bien plus large que les frontières de l’île.
Le séga, plus festif, a lui aussi évolué au fil des générations. Des bals lontan aux remix modernes, il reste le rythme qui rassemble toutes les générations, sur les places publiques comme dans les fêtes de famille.
Mais ces musiques ne sont pas figées dans le passé. De nombreux jeunes artistes réunionnais les réinventent, en y intégrant des sonorités électro, reggae ou hip-hop. Une façon de montrer que le maloya et le séga ne sont pas seulement des héritages, mais aussi des créations toujours vivantes.
Chaque tambour roulèr, chaque kayamb, chaque accord de séga raconte une histoire, et que préserver ces musiques, c’est préserver une partie de notre âme créole.
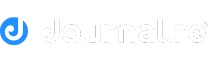





















0 Comments