Pendant près d’une décennie, La Réunion a vécu au rythme d’une menace permanente : celle des attaques de requins, concentrées le long de la côte ouest. Entre 2011 et 2019, vingt-quatre attaques ont été recensées, dont onze mortelles. Un traumatisme profond pour l’île, ses habitants, ses usagers de la mer et toute une économie liée aux activités nautiques. Aujourd’hui, après six ans sans incident, le surf retrouve peu à peu sa place — mais dans un contexte entièrement repensé, où la sécurité est omniprésente et les pratiques encadrées comme jamais.
génération marquée, mais qui retrouve peu à peu la mer
Sur la plage de l’Étang-Salé-les-Bains, Julie Levanti, 25 ans, découvre ce spot surveillé du sud-ouest. Comme beaucoup de jeunes Réunionnais, elle n’a pas grandi avec la certitude de pouvoir surfer librement :
« J’ai de moins en moins peur, mais on a toujours cette idée qui traverse l’esprit », confie-t-elle. « On voit des gens qui surfent tous les jours sans problème, ça rassure. »
Son témoignage illustre l’état d’esprit actuel : une envie de retour à l’eau, mêlée à une prudence encore très ancrée.
2011–2019 : une crise sans précédent qui a bouleversé l’île
Si la peur persiste, c’est que le traumatisme a été majeur. Le Centre Sécurité Requin (CSR) — structure publique chargée de gérer le risque requin — recense une série sombre de morsures :
- 48 attaques sur des humains entre 1980 et 2021,
- dont 25 attaques (11 mortelles) rien que de 2011 à 2019,
- 69 % des victimes sont des surfeurs.
La période 2011–2019 est devenue ce que les Réunionnais appellent désormais la “crise requin”, qui a bouleversé les pratiques nautiques. Les surfeurs, autrefois omniprésents sur les vagues de Saint-Leu, Trois-Bassins ou Boucan Canot, ont déserté les spots :
- le nombre de pratiquants réguliers a été divisé par huit entre 2011 et 2013,
- les écoles de surf ont fermé les unes après les autres, incapables de survivre.
C’est une filière entière — sportive, touristique et économique — qui s’est effondrée.
2013 : mise en place d’un arsenal inédit de protection
Face à l’ampleur du phénomène, l’État et les collectivités ont déployé un dispositif de sécurité parmi les plus stricts au monde. À partir de 2013 :
❌ Interdictions et zones sécurisées
- Interdiction de baignade, surf et bodyboard en dehors du lagon ou de zones spécifiquement sécurisées.
- Mise en place de filets anti-requins, régulièrement inspectés.
👁️ Surveillance technologique renforcée
- Drones pour scruter les espaces de surf.
- Jet-skis dédiés à la surveillance en continu.
- Patrouilles nautiques lors des créneaux autorisés.
🎣 Pêche ciblée
- Programme de « régulation » visant les espèces les plus dangereuses :
- requins-bouledogues,
- requins-tigres.
🔬 Études scientifiques
Le CSR a mené des campagnes pour analyser :
- les déplacements des squales,
- leur comportement,
- les facteurs environnementaux conduisant aux attaques (turbidité, fréquence, saisonnalité…).
Une stratégie contraignante… mais efficace : zéro attaque depuis 2019
Les mesures ont été parfois critiquées, jugées lourdes ou restrictives pour les usagers de la mer. Mais elles portent leurs fruits :
👉 Aucune attaque enregistrée depuis six ans.
C’est dans ce climat apaisé — mais toujours prudent — que la pratique du surf reprend doucement.
La renaissance du surf : écoles, pratiquants et nouveaux dispositifs
L’île comptait 14 écoles de surf avant la crise. Aujourd’hui, seules 8 sont encore en activité, mais certaines rouvrent ou émergent.
🎒 Exemple : Ti Vague Surf School
Inaugurée en juin, elle a affiché complet dès les vacances d’octobre.
Son fondateur, Antoine Delhon, constate un regain d’intérêt :
« Les gens reviennent. Ils ont parfois un peu d’appréhension, mais on les rassure. »
Même s’il reste loin de l’âge d’or d’avant 2011, le surf est bel et bien de retour.
Une surveillance millimétrée : Étang-Salé, Saint-Leu et les nouveaux protocoles
À l’Étang-Salé, le spot fonctionne grâce au dispositif de l’association Ressac. Benjamin André, responsable de brigade, détaille l’organisation :
👨✈️ Une équipe dédiée
- une dizaine de maîtres-nageurs sauveteurs,
- un jet-ski en mer en permanence,
- deux jet-skis supplémentaires à Saint-Leu.
🦈 Observation et évacuation
« En cas d’observation, on fait évacuer la zone immédiatement. »
💧 Analyse de la turbidité de l’eau
Un critère essentiel :
- Le surf n’est autorisé que si la visibilité dépasse 8 mètres,
- et si les conditions météo sont stables.
📍 Des passages réguliers de requins
Les surveillants observent encore un squale une fois par mois, en moyenne.
Mais les protocoles stricts — combinés à la surveillance — permettent de maintenir le risque à un niveau maîtrisé.
« Les dispositifs font leurs preuves. Et tout le monde apprécie de revoir de la vie sur les plages. »
Après des années de drame, de colère et de fermeture, La Réunion retrouve lentement l’une de ses identités maritimes les plus fortes.
Le surf renaît, mais dans un cadre entièrement repensé, où la sécurité est omniprésente et où chaque vague surfée reste empreinte de vigilance.
Le traumatisme n’est pas effacé — mais l’île réapprend, pas à pas, à vivre avec l’océan.
Source : lnc.nc
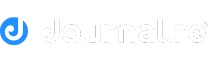










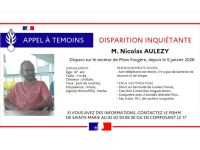










Le surf renaît en 2025 grâce à Ressac ???? Cela est très réducteur et occulte le travail fourni par la LRS et les vigies ainsi que celui du LTST avec la water Patrol. Dont Acte.
Pourquoi ne pas rappeler dans cet article que l’origine de la crise requin est le déversement en mer de 7 tonnes de déchets de poisson tous les 10 jours par l’armement ENEZ? Ils n’ont d’ailleurs jamais démenti ces quantités ahurissantes qui ont débuté en 2011 et ont duré 4 ans au moins. Ces déchets venaient de leur nouvelle usine car ils n’avaient pas encore de broyeur. C’est quand même la meilleure explication qui colle parfaitement, également, à la chronologie.