La Réunion est souvent présentée comme un modèle de métissage et d’harmonie. Pourtant, sous cette image idéalisée, se creusent des fractures sociales profondes. L’accès au logement, la domination économique des élites extérieures, la pression migratoire venue de Mayotte et l’absence de vision politique locale nourrissent un sentiment grandissant d’injustice et de déclassement.
Comprendre ces tensions nécessite de dépasser les discours simplistes : ce qui se joue aujourd’hui est moins un conflit entre communautés qu’un déséquilibre structurel entretenu par un modèle économique et institutionnel dépassé.
Un territoire attractif… qui pousse les Réunionnais vers la marge
Depuis trente ans, La Réunion attire des cadres métropolitains plus diplômés, mieux connectés et bénéficiant d’avantages financiers. Leur arrivée a accéléré une gentrification insulaire : hausse fulgurante du foncier, raréfaction du logement, étalement urbain et difficultés croissantes pour les classes moyennes réunionnaises de devenir propriétaires.
Les Métropolitains occupent une grande partie des postes stratégiques dans la fonction publique, l’éducation, la santé, la culture ou les médias. Leur domination dans les espaces de décision impose des normes et des codes venus de l’Hexagone, parfois déconnectés des réalités locales.
Résultat : une partie de la population réunionnaise ressent une exclusion symbolique et professionnelle, nourrissant un malaise identitaire.
Tensions sociales : les Mahorais, cibles d’un transfert de frustration
À La Réunion, les tensions ne relèvent pas d’un simple rejet culturel. Elles sont le résultat d’un système inégalitaire où les classes populaires, déjà fragilisées, voient arriver des populations encore plus précaires : les Mahorais.
Perçus comme concurrents dans l’accès au logement social, à l’école et aux aides, les Mahorais deviennent des bouc-émissaires dans une société où les inégalités structurelles ne cessent de s’accentuer.
Pourtant, ce rejet reflète une dynamique observée ailleurs : lorsque les ressources sont limitées, les rivalités se jouent horizontalement entre groupes vulnérables, alors que la cause profonde est verticale, liée au système économique et à l’accès au pouvoir.
Un développement bloqué par l’absence de vision politique
L’État mène une politique d’assistance plutôt que de développement. L’argent public afflue, mais les infrastructures structurantes manquent, les projets ambitieux peinent à voir le jour, et l’économie productive reste fragile.
Contrairement à la Corse ou la Bretagne, La Réunion n’a jamais imposé un projet politique propre, faute d’unité. Les partis locaux restent largement alignés sur les formations nationales.
Cette absence de stratégie partagée freine l’émergence d’un modèle économique fondé sur les besoins réels du territoire et entretient une dépendance chronique vis-à-vis de Paris.
Mayotte, les Comores et l’effet domino régional
La crise sociale et sécuritaire à Mayotte, nourrie par des décennies d’instabilité aux Comores, exerce une pression migratoire constante. L’arrivée de mineurs isolés – notamment les Dakou – et de familles en grande précarité renforce les inquiétudes réunionnaises et alimente un sentiment d’insécurité.
Si la France investissait dans le développement des Comores, une partie de cette pression diminuerait. Mais les tensions diplomatiques, le manque d’ambition géopolitique et l’indifférence nationale bloquent toute stratégie régionale cohérente.
Une identité politique réunionnaise fragilisée
Face aux défis sociaux, économiques et migratoires, La Réunion n’a pas réussi à fédérer un projet collectif, ni à construire une identité politique forte.
Sans vision, les décisions sont importées de l’Hexagone, inadaptées au territoire, et renforcent la frustration citoyenne, ouvrant la voie à un repli identitaire potentiellement dangereux.
Se réveiller avant qu’il ne soit trop tard
Les fractures qui traversent La Réunion ne sont pas irréversibles. Mais elles ne disparaîtront pas sans :
- une révision profonde de la politique de l’État dans l’océan Indien,
- une structuration politique réunionnaise forte,
- un modèle économique moins dépendant et plus productif,
- un plan d’apaisement et de cohésion sociale fondé sur les réalités locales.
À défaut, l’île risque de voir s’enraciner des divisions qui menacent son vivre-ensemble et son avenir.
Source : Dr. Laurent Médéa, Sociologue
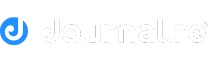





















« Si la France investissait dans le développement des Comores… »
Sauf qu’en fait elle le fait déjà : https://www.afd.fr/fr/ressources/lafd-et-les-comores#:~:text=Depuis%20les%20ann%C3%A9es%2060%2C%20la,France%2DComores%20(PDFC).