« Pas divorcée, pas de logement. Se faire battre, on a le droit et on ne doit pas fuir. Être malheureuse, il faut rester. » Ces mots, durs et crus, viennent d’une femme réunionnaise victime de violences conjugales. Derrière ce témoignage se cache une réalité partagée par beaucoup : malgré les discours officiels et les réformes annoncées, la justice tarde encore trop souvent à protéger celles qui en ont le plus besoin.
La violence conjugale ne se limite pas aux coups. Elle est aussi psychologique, économique et sociale. Être privée de logement, dépendre financièrement d’un conjoint violent, attendre une décision de justice qui n’arrive pas : autant de formes d’emprise qui enferment les victimes.À La Réunion, certaines femmes expriment ce désarroi par des mots simples mais lourds de sens : « Où est le droit de la femme ? Rester pour souffrir et être sous l’emprise. »
Les procédures judiciaires prennent souvent des mois. Pour l’aide juridictionnelle, indispensable à celles qui n’ont pas les moyens de financer un avocat, le délai peut atteindre six mois. Quant aux ordonnances de protection, qui devraient être délivrées dans un délai légal de six jours, elles se heurtent à un manque de juges et à des dossiers qui s’accumulent.Résultat : des femmes continuent de vivre sous le même toit que leur agresseur, en danger, faute de décision rapide.
Beaucoup de victimes expriment le sentiment que « l’homme a tous les droits ». Conserver le logement familial, bénéficier de démarches accélérées, voir sa parole davantage écoutée : autant d’éléments qui renforcent l’impression d’un système judiciaire encore marqué par des stéréotypes de genre.
À La Réunion, les violences intrafamiliales représentent plus de 50 % des affaires criminelles. En 2024, près de 4 500 plaintes ont été enregistrées pour des violences au sein du couple. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.Ces statistiques rappellent l’urgence d’une action efficace et rapide.
Face aux lenteurs judiciaires, ce sont les associations qui assurent la première protection : l’Arajufa, Femmes Solid’Air, CIDFF Réunion ou encore SOS Violences Familiales. Mais toutes dénoncent un manque de moyens et une demande croissante qu’elles ne peuvent assumer seules.
Sur le papier, la France dispose de dispositifs avancés : éviction du conjoint violent, téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement. Mais leur mise en œuvre reste inégale. Faute de juges, de suivi, ou de formation, ces outils ne parviennent pas toujours jusqu’aux victimes.
Attendre une aide juridictionnelle, une ordonnance de protection, une place en hébergement d’urgence… Chaque délai ajoute une souffrance supplémentaire. Chaque jour passé dans l’incertitude met les victimes davantage en danger.
Au-delà des institutions, la société porte aussi une responsabilité : les voisins qui n’osent pas intervenir, les familles qui conseillent de « rester pour les enfants », les collègues qui ferment les yeux. Le silence, la banalisation et la culpabilisation aggravent encore la détresse des victimes.
Des solutions existent : réduire les délais judiciaires, renforcer les moyens des associations, développer l’hébergement d’urgence, et surtout, changer les mentalités. L’éducation au respect et à l’égalité dès le plus jeune âge reste l’un des leviers les plus puissants.
« L’homme a tous les droits », confie cette victime. En théorie, ce n’est pas vrai. Mais dans la pratique, trop souvent, c’est le cas. Tant que la justice et la société n’apporteront pas des réponses rapides et concrètes, des femmes continueront de vivre dans la peur et dans l’attente.
Parce qu’aucune femme ne devrait entendre ces mots lorsqu’elle demande de l’aide : « Il faut attendre. »
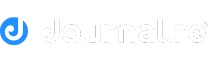






















0 Comments